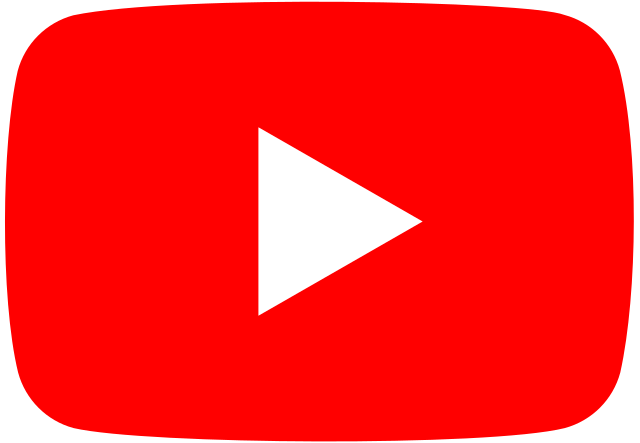La loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe a confié à la CNCDH le mandat de rapporteur national indépendant sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie ; elle remet chaque année un rapport au Premier ministre.

Mis à jour le 1 septembre 2025
Ce mandat est arrimé à la Convention internationale relative à l’élimination de la discrimination raciale (CERD).
Le 21 mars de chaque année, date retenue par l'Organisation des Nations Unies pour la journée internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale la Commission nationale consultative des droits de l'homme remet un rapport sur la lutte contre le racisme. Ce rapport est immédiatement rendu public.
Article 2, Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite et xénophobe
Le rapport remis par la CNCDH
Conformément à la loi n°90-615 du 13 juillet 1990, en sa qualité de Rapporteur national sur la lutte contre le racisme, la Commission nationale consultative des droits de l’homme remet chaque année au Gouvernement un Rapport qui dresse un état des lieux du racisme, de l’antisémitisme et de la xénophobie en France, ainsi que des moyens de lutte mis en œuvre par les institutions de la République et la société civile.
La CNCDH formule une série de recommandations visant à mieux combattre toutes les formes de racisme.
Dresser un état des lieux du racisme en France relève d’un processus complexe et délicat. La CNCDH fonde ses analyses et ses recommandations sur la base d’outils variés et complémentaires comme le bilan statistique du ministère de l’Intérieur, celui du ministère de la Justice, les enquêtes sur l’état de l’opinion, les analyses des chercheurs partenaires de la CNCDH, et en particulier leur indice longitudinal de tolérance et les contributions des acteurs institutionnels, associatifs et internationaux spécialisés dans la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie et aussi contre la haine anti-musulman ou l’antistiganisme.
L’Indice de tolérance
L’Indice longitudinal de tolérance (ILT), créé en 2008 par Vincent Tiberj, professeur des universités associé à Sciences Po Bordeaux, vise à mesurer de manière synthétique l’évolution des préjugés en France métropolitaine depuis 1990.
Cet indice se fonde sur l’enquête sur l’état de l’opinion, commandée par la CNCDH depuis 1990.
« L’évolution de la tolérance reflète la manière dont collectivement notre société construit son rapport à l’altérité. Les citoyens, quelles que soient leurs caractéristiques sociales et politiques, sont ambivalents sur ces questions. En chacun de nous coexistent des dispositions à l’ouverture aux autres ou à la fermeture. La domination des uns sur les autres dépend du contexte, de l’éducation, et particulièrement de la manière dont les élites politiques, médiatiques et sociales parlent et racontent l’immigration et la diversité. »
La courbe de l’indice longitudinal de tolérance traduit les chocs conjoncturels. Tendanciellement, l’évolution est à la hausse. Cette hausse depuis 1990 s’explique par des facteurs structurels suivant : l’élévation du niveau de diplôme et le renouvellement des générations. Elle est amplifiée par les expériences interculturelles de la population et par les discours politiques de tolérance.
Racisme et xénophobie
Approche universaliste de la lutte contre racisme
La CNCDH porte l’approche universaliste inscrite dans le cadre constitutionnel français. L’article Premier de la Constitution consacre le principe d’égalité « de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. »
Il s’ensuit que la loi prohibe les actes infractionnels commis « à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance, ou de leur non-appartenance, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
Fidèle au cadre républicain, la CNCDH estime que la lutte doit porter sur toutes les formes de racisme. Chacune a bien sûr une histoire et des spécificités qui lui sont propres. Ainsi, le racisme anti-Roms ou antitsiganisme est la forme de racisme la plus banalisée aujourd’hui. L’antisémitisme est la forme de racisme qui a la plus longue histoire, profondément marquée par la Shoah. Le racisme anti-Noirs ou négrophobie est marquée par l’histoire de l’esclavage et des préjugés animalisants.
Au-delà de ses fondements textuels, le cadre universaliste est aussi le cadre le plus opérationnel pour lutter efficacement contre le racisme. Les préjugés envers les minorités partagent nombre de traits communs. Quelle que soit leur cible, dans l’ensemble, ils évoluent pareillement dans le temps, ils sont à des degrés divers corrélés entre eux, ils s’expliquent largement par les mêmes facteurs, ils renvoient à des argumentaires souvent similaires.
Les études de la CNCDH montrent ainsi que la xénophobie, le sentiment anti-immigré est le plus corrélé aux autres formes de haine. Plus on rejette les immigrés, plus on rejette les personnes perçues comme juives, musulmanes, asiatiques, noires, les personnes LGBTI et les femmes émancipées.
Focus sur certaines formes de haine de l’Autre
Fidèle au cadre républicain, la CNDH estime que, pour être respectueuse des principes constitutionnels et efficace, la lutte contre chaque forme de racisme doit s’inscrire dans une approche universaliste.
Elle est d’avis qu’il ne faut jamais opposer les groupes et qu’adopter une définition spécifique de telle ou telle forme de racisme fragilise l’approche républicaine du combat anti-raciste.
Antisémitisme
L’antisémitisme est la forme de racisme qui a la plus longue histoire et qui, depuis la Shoah, tend à devenir l’aune à laquelle se mesurent les autres formes de racisme.
Par une résolution du 3 décembre 2019, l’Assemblée nationale a adopté la définition opérationnelle de l’antisémitisme utilisée par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA).
Fidèle à la conception universaliste républicaine, la CNCDH est d’avis qu’adopter cette définition fragilise l’approche républicaine du combat antiraciste. Elle estime que cette définition de l’antisémitisme est en outre discutable en ce qu’elle ne concorde pas avec l’antisémitisme qui s’exprime en France dont elle mesure chaque année l’évolution et l’intensité dans les préjugés au travers de l’enquête CNCDH-SIG-IPSOS.
Antitsiganisme
Année après année, le Baromètre racisme de la CNCDH indique que les personnes Roms et les Gens du voyage sont les personnes les moins bien acceptées par les Françaises et Français. La CNCDH insiste régulièrement sur l’urgence de lutter contre les préjugés et stéréotypes qui les concernent.
Les préjugés les concernant font le lit de multiples discriminations affectant les personnes Roms dans tous les domaines de la vie : l’accès au logement, la scolarisation, la santé, l’emploi…
L’adoption d’une stratégie nationale 2020-2303 en réponse à la recommandation du Conseil de l’Union européenne du 12 mars 2021 pour « l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms » et l’ajout explicite de la lutte contre l’antitsiganisme dans le plan national d’action de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liés à l’origine 2023-2026 constituent des avancées certaines. La CNCDH alerte cependant sur la nécessité de consacrer les moyens humains et financiers suffisants pour mettre en œuvre ces actions.
La CNCDH coopère régulièrement avec la DIHAL (Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement) ainsi qu’avec diverses associations.
Racisme antimusulman
Le racisme antimusulman est une forme de racisme qui s’ancre dans des stéréotypes ciblant une population perçue à travers le prisme de l’islam, souvent essentialisée et confondue avec l’extrémisme religieux. Les discours antimusulmans s’articulent avec d’autres formes de racisme comme l’antisémitisme ou la xénophobie ou d’autres formes de rejets comme le sexisme ou la haine anti-LGBT
La Commission évalue chaque année les préjugés à l’égard des personnes musulmanes à travers son Baromètre CNCDH-SIG-IPSOS, afin de mieux cerner les évolutions de cette forme de racisme. Ce sondage établit au fil des années que ces dernières/les personnes musulmanes restent le deuxième groupe de population le moins bien perçu après les Roms.
Racisme anti-Noirs
Si, au niveau des opinions, les Noirs sont une des minorités les mieux acceptées, les personnes noires sont dans les faits parmi les plus discriminées. Elles continuent cependant à subir de nombreux stéréotypes s’inscrivant dans un continuum historique et culturel raciste lié à l’esclavage et à la colonisation.
Les discriminations
La CNCDH insiste sur la nécessité de combattre tous ces racismes via une approche globale et universelle, sans hiérarchisation des discriminations. Elle insiste également sur le caractère intersectionnel des discriminations qui se cumulent : racisme, antisémitisme, xénophobie, racisme antimusulman, antistiganisme, racisme anti-Noir, racisme anti-asiatique avec les discriminations liées au sexe, à l’âge, au handicap, … Elles ne peuvent être conçues individuellement ; elles s’inscrivent dans des dynamiques complexes comme le souligne le Baromètre annuel de la CNCDH.
Le cadre international
Toutes les conventions internationales des droits de l’Homme portent un article prohibant les discriminations.
Etant l’Institution nationale des droits de l’Homme, la CNCDH contrôle le respect par la France de ses engagements internationaux en la matière. Elle interagit de façon très régulière avec le Comité des Nations unies chargé du suivi de la Convention internationale sur l’élimination de la discrimination raciale. Elle interagit également avec la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance.
Le cadre juridique national
Les libertés d’expression et d’opinion sont des droits fondamentaux, essentiels à la démocratie et au pluralisme. Pour autant, le racisme sous toutes ses formes (antisémitisme, haine antimusulman, antitsiganisme, xénophobie…) est puni par la loi : le droit de s’exprimer s’arrête là où commence l’abus, comme le rappellent l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le droit français sanctionne la diffamation et l’injure à caractère racial, l’apologie des crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, la contestation de crimes contre l’humanité. Ces infractions peuvent donner lieu à des amendes ou à des peines d’emprisonnement, selon les dispositions du Code pénal, de l’article L1132-1 du Code du travail, ainsi que de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.